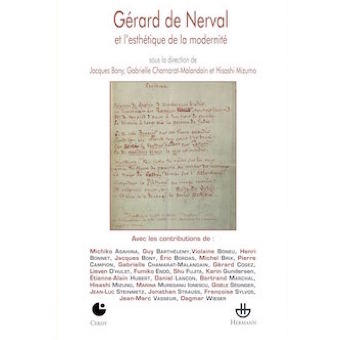Sous la direction de Jacques Bony, Gabrielle Chamarat-Malandain et Hisashi Mizumo.
Ouvrage publié avec le soutien de l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3.
La célébration du bicentenaire de la naissance de Gérard de Nerval à Cerisy-la-Salle a permis la découverte ou la redécouverte d'une oeuvre qui a trouvé son authenticité grâce au travail considérable représenté par la nouvelle édition de la Pléiade, dirigée par Jean Guillaume et Claude Pichois. Ce recueil, composé à partir des Actes de ce colloque de 2008, se fonde entièrement sur ce nouvel établissement au travers d'articles nombreux et variés abordant le texte nervalien sous ses multiples aspects - poésie, traductions, récit de voyage, essais, drames, nouvelles - tout en mettant en lumière cette unité étrange dans la diversité qui la caractérise. C'est pourquoi le terme, au demeurant bien galvaudé, de «modernité», reprend ici tout son sens. Le texte sur lequel s'appuient les nombreux articles recueillis dans ce livre, est rendu à son authenticité, et abordé d'un oeil neuf, tel que le XXIe siècle peut désormais le lire, l'interpréter, le replacer dans sa propre histoire, celle du XIXe siècle et de sa postérité. Mal connu ou peu reconnu en son temps, Nerval a été longtemps considéré comme un écrivain mineur, un marginal. La rêverie et la folie que certains textes prennent pour objet ont amené la critique à se complaire dans cette exaltation de l'imaginaire, sans en voir les limites. Elle passait ainsi à côté, non seulement de textes essentiels, mais d'un écrivain «toujours lucide», selon l'expression de Baudelaire. Elle isolait l'oeuvre de Nerval au lieu de la considérer comme étroitement située dans l'histoire littéraire et l'histoire de son temps, tout en proposant une écriture, vers ou prose, qui ouvrait parallèlement sur une poétique originale. Chaque intervention de ce recueil apporte son lot de redécouvertes, d'éclaircissements et d'observations précises. Les articles éclairent le rapport entre Nerval et notre contemporanéité, cette dernière passant souvent par le dévoilement d'une originalité qui a parfois déconcerté ses propres contemporains.
Extrait de l'introduction
Ce recueil présente les communications qui ont été prononcées au colloque du bicentenaire de la naissance de Nerval, en août 2008 à Cerisy-la-Salle. Le titre général en était la modernité, mot bien galvaudé au demeurant, de l'oeuvre de Nerval. Le mot très vague avait néanmoins l'avantage d'être d'une amplitude large. Il permettait de présenter, à l'intérieur d'un long colloque, un écrivain dont l'approche devait être complètement reconsidérée après le nouvel établissement du texte et l'apparat critique que Jean Guillaume, Claude Pichois et leurs collaborateurs avaient proposés dans l'édition de la Pléiade. Le texte, rendu à son authenticité, pouvait donc être abordé d'un oeil neuf quel que soit le point de vue envisagé. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, chaque intervention apportant son lot de redécouverte depuis le travail d'éclaircissement de textes célèbres, jusqu'au rapport considéré entre notre auteur et notre contemporanéité, en passant par le dévoilement d'une originalité qui a souvent déconcerté ses propres contemporains.
Ce livre s'ouvre donc sur différents articles dont chacun, donne une idée des avancées de la critique sur la poétique nervalienne. Viennent d'abord deux contributions qui selon des modes d'approche différents permettent de reconsidérer la composition des Chimères. Jean-Luc Steinmetz analyse l'élaboration du recueil dans le temps, entre les «Préchimères» de 1841 jusqu'à la publication définitive à la fin des Filles du Feu, en 1854. En 1844 et 1855, Nerval publie ce qui était assimilable par le lecteur de son temps. Mais, J. L. Steinmetz attribue à la publication intermédiaire dans la section «Mysticisme» de Petits Châteaux de Bohêmeun rôle essentiel quant à l'interprétation de la disposition des sonnets. Se suivent la mort du monde représentée par "Le Christ aux Oliviers" en rapport avec la mort de la femme aimée dans Daphné, puis la sagesse supérieure de "Vers dorés". Les Chimères de 1853, ne sont qu'une extension de cette trajectoire du désespoir à la résignation, même si le dernier mot de cette interprétation est celui d'une «non révélation» des Chimères. Bertrand Marchal revient sur l'«hermétisme» des Chimères en comparant le sonnet intitulé en 1841 "A Mad Aguado" et, en 1853, "Erythrea". Nerval a pour modèle le pantoum malais qui repose sur la logique de deux développements étrangers l'un à l'autre. Ce modèle correspond bien à l'incohérence du sonnet nervalien qui, contre l'Art poétique d'Horace, revendique une poétique de la chimère «sans queue ni tête». Le syncrétisme bien connu de Nerval explique par ailleurs les superpositions du sens et en particulier, celui de la figure féminine centrale Lanassa puis Mahdéwa qui se décompose en pluralité de possibles. C'est bien d'une poétique complexe qu'il s'agit, mais qui n'a rien à voir avec la folie.